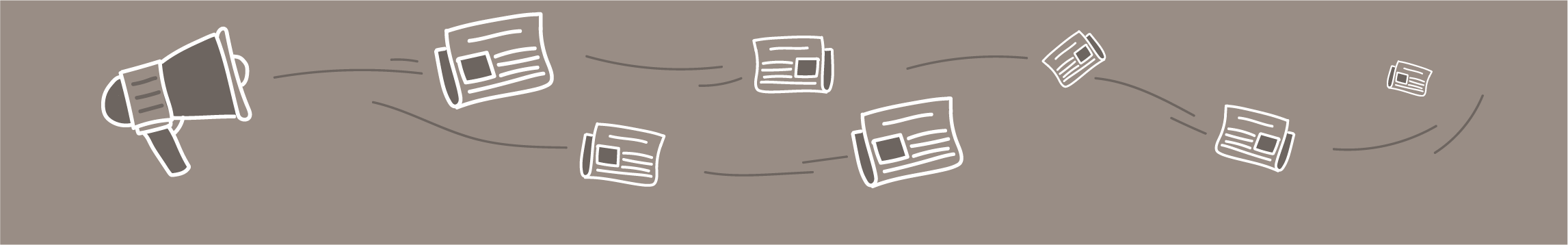Le 10 septembre 2024 à 19h54, une explosion s’est produite dans l’atelier d’hydrolyse des résidus de fabrication de sodium métallique du site MSSA de Saint-Marcel (Savoie), spécialisé dans la production de sodium et lithium. Aucun blessé n’est à déplorer, mais une forte détonation et un panache de fumée ont été observés. L’événement, géré en interne, a conduit à une remise en service de l’atelier dès le lendemain.
La production de sodium génère des résidus très réactifs qui sont éliminés soit par brûlage puis hydrolyse, soit par hydrolyse directe. Le processus d’hydrolyse directe, s’il est mal maîtrisé, présente un risque élevé d’explosion du fait de la réaction exothermique entre le sodium et l’eau, qui génère de l’hydrogène.
La remise en route rapide de l'installation et l'absence de données suffisantes sur les circonstances de l'évènement ne permettent pas au BEA-RI d'établir précisément les causes de cet évènement qui n'est pas exceptionnel pour ce site, pouvant survenir plusieurs fois par an. L'enquête technique a néanmoins permis d'identifier des causes possibles liées aux résidus traités (composition ou géométrie) ou à l'installation (état du panier utilisé pour le conditionnement des résidus placés à l'hydrolyse ou mauvais fonctionnement des buses d'aspersion d'eau).
Les résidus de sodium métalliques sont très réactifs. Il n'apparait donc pas opportun de les transporter hors du site pour les traiter ailleurs et un traitement en flux continu au plus près et au plus tôt après leur soutirage est une bonne pratique. Le brûlage préalable des résidus permet de réduire leur réactivité à la condition de pouvoir réaliser un brûlage suffisant et bien homogène.
L’enquête liste plusieurs facteurs contributifs ayant pu influer sur les évènements rencontrés lors de l'hydrolyse. L’organisation du traitement des résidus présente des fragilités structurelles : manque de traçabilité des lots traités, tri manuel reposant sur le jugement des opérateurs, brûlage manuel potentiellement incomplet, installations anciennes, et pression importante pour résorber un stock ancien de déchets. A cet effet la capacité de traitement a déjà été doublée par l’industriel.
Le BEA-RI émet les recommandations suivantes à l’exploitant :
- Mettre en place une traçabilité plus complète du traitement des résidus de fabrication permettant d'identifier des schémas accidentogènes récurrents ou des points faibles dans le processus, notamment en :
o identifiant les déchets à toute étape du processus de traitement (entreposage, brûlage, concassage, hydrolyse), en lien avec leur provenance (et donc potentiellement leur réactivité) et le traitement qui doit leur être appliqué ;
o traçant précisément le déroulement de chaque poste au brûlage comme à l'hydrolyse, en enregistrant notamment les caractéristiques des résidus traités, les difficultés rencontrées et les actions mises en œuvre ;
- Fiabiliser les pratiques actuelles (en associant les opérateurs), notamment les sujets suivants :
o Sur le brûlage et le concassage : préciser les durées de brûlages (en préconisant des durées minimales), les quantités maximales à traiter par opération, les durées de malaxage, les contrôles à réaliser à l'issue de l'opération pendant le concassage pour valider l'efficacité de l'opération et modalités de gestion des non conformités ;
o Sur l'hydrolyse : Améliorer la surveillance des opérations en renforçant la métrologie (par exemple : détecteur de gaz, capteur de température, caméra thermique), préciser les temporisations et les plages d'utilisation (paramètres à suivre, valeurs limites et actions associées) ;
o Sur la maintenance préventive des postes "brûlage" et "hydrolyse" : préciser le programme de maintenance visant à en garantir le bon fonctionnement dans le temps (entretien des équipements d'injection d'eau, des extractions d'air, des conditionnements utilisés).
- Lancer un programme de recherche et développement, pouvant associer des partenaires externes (université, entreprises spécialisées dans l'élimination des déchets dangereux, …), pour réinterroger les pratiques actuelles dans l'optique de trouver des solutions plus sûres :
o réexaminer le processus de soutirage sous deux angles : la possibilité de mettre en place un traitement des résidus en mode continu, la recherche d'un format optimum des résidus à hydrolyser (taille, géométrie) ;
o poursuivre le projet d'automatisation de l'étape de brûlage ;
o engager une réflexion sur les équipements mis en œuvre dans l'étape d'hydrolyse et son automatisation dans le but de mieux maîtriser l'émission de H2.
- S’assurer que les moyens humains et matériels sont suffisants pour que toutes les étapes du processus (tri, brûlage, concassage, vérification, et hydrolyse) puissent être mises en œuvre dans de bonnes conditions de sécurité y compris en période de résorption du passif. Cette analyse pourra intégrer la composition des équipes de travail, l'organisation des postes et les équipements de protection individuels dont les opérateurs doivent s'équiper, ainsi que leur formation (risques inhérents aux produits et process, compréhension des modes opératoires, pilotage et analyse critique du fonctionnement des installations, et gestion des situations incidentelles et accidentelles) ;
- Réaliser un audit externe de sécurité industrielle du site, afin d'identifier et hiérarchiser les axes d'amélioration. Cet audit pourrait en particulier traiter des aspects suivants :
o prévention des risques d’incendie et d’explosion ;
o résilience du site face à des situations dégradées ;
o interface homme / machine sur les différents postes de travail ;
o gestion des interventions ;
o culture de sécurité
Explosion survenue au sein d’un atelier du site exploité par la société MSSA à Saint-Marcel (73), site classé SEVESO seuil haut
Environnement et Énergie - Actualité Scientifique - Publiée le jeudi 28 août 2025